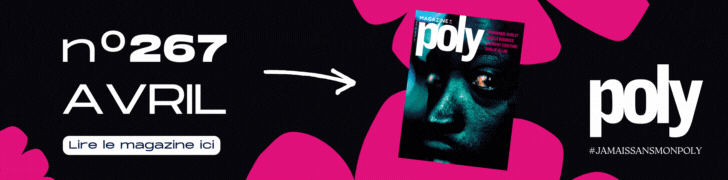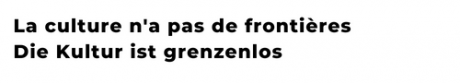Avec C’est comme ça (si vous voulez), Julia Vidit poursuit sa mise en crise de la vérité au théâtre. Dans cette comédie pirandellienne, elle s’inspire de la caricature, reflet le plus fidèle de l’individu, pour questionner la violence qui guette notre vaine recherche de certitudes.
Comment avez-vous découvert cette pièce peu connue de Pirandello, auteur plus que prolifique ?
Je l’ai lue par hasard et comme je suis particulièrement intéressée par les questions d’illusion, de réalité et plus globalement de la perception du vrai au théâtre, je l’utilise en exercice de vérité. Cette pièce est une équation très complexe à résoudre et accepter. Elle évoque le trouble, l’impossibilité de savoir qui est l’autre. Comme s’il nous disait qu’on peut savoir qui on est pour soi, mais jamais qui on est pour l’autre. Surtout que nous changeons, même pour nous-même. Dans cette période pré-fasciste de 1917, suivant le Risorgimento où l’unité italienne s’est construite avec l’intégration de la Sicile, des notables d’une petite ville sont confrontés à l’arrivée de trois personnes. Elles se comportent de manière bizarre, notamment cette mère et sa fille qui ne se voient pas et communiquent par une fenêtre, ce qui est insupportable pour le voisinage. Ils ont peur de perdre quelque chose, sentiment lié à l’arrivée des pauvres du Sud dans le Nord plus riche après un tremblement de terre dans les Abruzzes qui a existé et fait énormément de morts. Pirandello est génial et très joueur dans sa construction dramaturgique : il fait demander par les voisins des explications à la mère, puis au fonctionnaire Ponza interrogé sur sa femme, avant que la première ne donne une troisième version. On en appelle donc au commissaire de police et au Préfet. Personne n’arrive à dénouer les choses jusqu’à l’arrivée du troisième personnage voilé, qui est la vérité voilée ! Dans tout cela, il place un double de lui-même, l’Oncle Laudisi, qui sera un démiurge acceptant le doute et se moquant de cette recherche de vérité de la communauté.
Le prétexte pour les notables consiste en la supposée séquestration de sa femme par Ponza…
Si les notables veulent dénouer ce mystère, c’est qu’au fond ils cherchent une réponse bien plus grande à leur existence : pourquoi sommes-nous là ? Leur quête de sens provoque une violence qui est celle du fascisme. En s’acharnant, ils établissent des systèmes de vérité pour trouver leurs réponses, quitte à ce que cela dégénère. Cette réponse les occupe, comble la question du sens de l’existence chère à Camus.
L’idée qu’il y aurait en germe le fascisme à venir se joue dans cette incapacité à accepter que d’autres vivent autrement et cachent des choses ?
Le penseur italien Giovanni Macchia a écrit de Pirandello qu’il est un auteur fabriquant une chambre des tortures. Il joue avec nous, nous prend à notre propre piège. Placé en voyeur de cette histoire, le public a envie de savoir. En bon tortionnaire, il fait tomber la pièce de monnaie sur la tranche pour clore son texte : Madame Ponza arrive voilée et dit « Je suis celle que l’on veut que je sois. Je suis celle que l’on croit que je suis. » Ce qu’on peut mettre dans la bouche de certaines prostituées : appelle-moi comme tu veux. Une forme d’émancipation absolue qui affirme qu’on se fiche de prouver qui on est ! J’avais donné cette pièce à l’auteur Guillaume Cayet en 2017. On s’est dit qu’elle ne pourrait finir comme cela aujourd’hui, se demandant ce qu’il se passerait. La violence se déchainerait pour découvrir qui elle est et ce qu’elle cache. Si leur quête de vérité va jusqu’au bout, elle aboutit à la violence totale. Il y a deux escaliers en hélices de part et d’autre d’un entresol. L’illusion amenée par le code de jeu des comédiens fait qu’ils semblent monter sans cesse. Nous nous y perdons comme dans ceux d’Escher. Dans l’acte très comique que nous rajoutons avec Guillaume, ils se retrouvent à la cave : rencontre d’Éros et Thanatos. On finit par toucher à l’absurde.
Vous faites de Laudisi un homme assumant des codes féminins en se travestissant. C’est comme un bouffon à la cour du roi pouvant tout dire car il est à part et reconnu comme tel ?
Laudisi est le contrepoint de la communauté tout en étant en son sein. Cet homme vivant dans une famille bourgeoise assume de vouloir être une femme et devient un contrepouvoir. La violence vient de sa famille qui continue de l’appeler tonton. Ils ne veulent pas voir, ce qui est savoureux pour des gens recherchant la vérité à tout prix. Cela questionne ces communautés ayant des valeurs extrêmement fortes. Parce qu’au fond, qu’est-ce qu’on en a à faire de ce qu’il y a dans la culotte ? Accepter l’autre dans sa complexité et dans ce qu’il a de contradictoire est trop difficile pour eux.
La plus belle trouvaille de Pirandello n’est-elle pas la force de l’imaginaire : que chacun y projette des choses à soi en quête de certitudes impossibles ?
Si ! La recherche de vérité est morbide, car la seule que nous connaissons c’est la mort. Le doute c’est la vie, l’incertitude, l’instabilité. C’est ce que dit Camus : l’unique question philosophique qui vaille la peine, c’est le choix du suicide ou pas. Sujet tabou, mais cela reste un choix. Le théâtre est le lieu du vivant qui nous rappelle que l’on va mourir.
Vous citez aussi Jean-François Revel : « On appelle caricature aussi bien la déformation sans intention comique que le dessin comique sans déformation. »
Nous travaillons dessus avec les acteurs. Je pense que cela convoque la conscience de l’acteur, celle qu’il a de ce qu’il donne à avoir. Je ne suis pas dans une recherche d’oubli de soi : quand on est en scène, on doit être conscient de ce que l’on fait et de ce qu’on y montre. L’écriture de Pirandello est très concrète. L’intrigue avance, mais comment grossir cela tout en restant crédible ?
Y a-t-il une peur de se faire avoir par l’auteur et sa mécanique bien huilée, y perdant peut-être ce qui se joue derrière ?
Comme dans un château de cartes, Ponza et Madame Frola ont une version différente des choses, mais chacun permet à l’illusion de l’autre d’exister. Madame Frola a une fille. Ponza, une femme. Le dilemme est que lui affirme que sa femme est morte, et que l’actuelle est sa seconde femme. Mais que Madame Frola pense que c’est toujours sa fille, encore vivante. De son côté, Madame Frola assure qu’il est possessif et qu’elle a dû lui enlever sa fille qui en souffrait pour la placer en maison de santé. À sa sortie, il ne l’a pas reconnue. Elles auraient alors simulé un second mariage pour qu’enfin il la reconnaisse comme sa femme. Chacun pense de l’autre qu’il est fou et l’entretient dans cette illusion.
Au Théâtre de la Manufacture (Nancy) du 1er au 6 mars puis en tournée au Nest (Thionville) les 9 & 10 mars et au Salmanazar (Épernay) le 3 mai
theatre-manufacture.fr