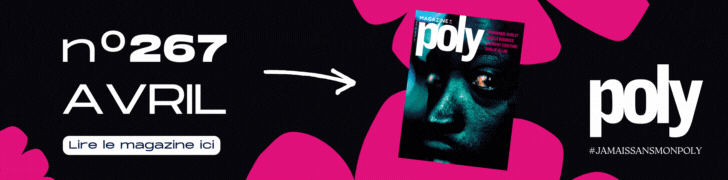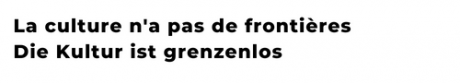O Rossini mio !
Pour sa 30e édition, le festival « Rossini in Wildbad » a mis les petits plats dans les grands avec une programmation plus inédite et ambitieuse que jamais. Une édition anniversaire aux quatre opéras et multiples manifestations, y compris une diffusion en live streaming, dont on retiendra surtout la haute qualité vocale. Le tout sous le soleil, dans la charmante ville bucolique et thermale de Bad Wildbad. Une pépinière de nouveaux talents à visiter absolument, en pleine Forêt Noire…
Quand on a essayé le festival Rossini de Bad Wildbad, à moins de deux heures de voiture de Strasbourg si l’on choisit la bonne route (en passant par Gaggenau, possible étape thermale de charme), soit on y retourne tous les ans, soit on boude l’atmosphère bon enfant et les défauts inhérents à la structure, en se disant que, décidément, Rossini, c’est Pesaro, sinon rien. À la rédaction de Poly, cela fait longtemps que le pli est pris : ainsi, en se concentrant sur un week-end, on peut voir la quasi-totalité des opéras et concerts phares de « Rossini in Wildbad », tout en s’accordant – et c’est à deux pas – des plages de temps de détente dans les superbes thermes orientalisants ou un peu plus actifs dans le Vital Therme voisin. Bad Wildbad est également connue pour ses sentiers de promenade et ses beaux départs de randonnées que l’on peut rejoindre en utilisant le petit funiculaire tout proche. Le rapport entre la forêt, l’eau thermale et Rossini ? Gioacchino s’est accordé en ces lieux une cure en 1856 (ce que rappelle, en face des bains, une statue peu flatteuse pour le vieux maître, représenté en train de mettre le doigt de pied dans l’eau, se vrillant autour de sa serviette, doté d’un embonpoint conséquent) et cela a suffi à créer un festival de belcanto autour du célèbre amateur de tournedos.
Pour ce cru exceptionnel des trente ans, le sémillant Jochen Schönleber, intendant et metteur en scène depuis 1991, a choisi de renouveler la performance de l’an passé, avec pas moins de quatre opéras de Rossini lui-même. Pas de thème émergent, comme la sélection d’un pays (la Suisse, en 2013, avec Guillaume Tell donné en même temps que le rarissime Chalet d’Adam ou d’un problème précis (les amours impossibles de tourtereaux appartenant à des pays en guerre, par exemple, comme pour Maometto II et Aureliano in Palmira l’an passé, dont on pourra retrouver la chronique). Cette année, ce sont deux opéras de jeunesse qui seront à comparer avec deux œuvres de fin de carrière, dont le Moïse et Pharaon, au titre familier pour le grand public quoique rarement visible.
Comme toujours, les productions, dotées d’un tout petit budget, sont minimalistes, voire un peu foutraques. Il faut dire que la manifestation doit composer avec les défauts de ses qualités : le petit théâtre de deux cents places restauré en 2014, la Trinkhalle d’une capacité de quatre cents sièges permettent d’éviter les grosses foules et l’anonymat des grandes machines festivalières, mais évidemment, on se doute bien que la billetterie ne parviendra pas à faire décoller financièrement le festival (désespérément à la recherche de mécènes généreux). Les spectacles font cependant le plein et heureusement, sont systématiquement ou presque enregistrés et filmés avec des parutions de CD et DVD sous le label Naxos, disponibles pour certains sur le site touristique de la ville.
Cette année, deux concerts auxquels nous n’avons pas assisté, dont l’adorable Petite messe solennelle, avaient lieu dans la Tour du Baumwipfelpfad. C’est bien dommage, car le sentier des cimes sur la passerelle en bois suspendue dans les arbres où l’on chemine en pente douce avant d’arriver à une spirale qui s’achène en belvédère de 40 mètres de haut avec vue superbe sur la Forêt Noire jusqu’aux Alpes suisses (on retient son souffle), est spectaculaire à souhait… Mais il restait largement de quoi se mettre sous la dent au cours du dernier week-end du festival, du jeudi 26 au dimanche 29 juillet 2018.
Le Nozze di Teti e di Peleo
Notre festival commence le jeudi à la Trinkhalle avec une soirée exceptionnelle : il s’agit du concert du jubilé où on a choisi une cantate courte (une petite heure à peine) composée pour le mariage de la princesse Marie Caroline et du duc de Berry en 1816. Pour l’occasion, le chef Pietro Rizzo, belcantiste avéré, dirige pour la première fois l’orchestre attitré du festival, les excellents Virtuosi Brunenses. Le tout, naturellement, va donner lieu à l’édition d’un CD.
L’intendant vient sur scène non pas pour faire un discours de circonstance, mais pour annoncer que Pélée, alias Mert Süngü, est souffrant, néanmoins disposé à chanter tout de même. De fait, le ténor se sort très bien de l’exercice périlleux et s’appuie sur une technique déjà éprouvée pour que ses aigus éclatants ne pâtissent en rien de son indisposition. Eleonora Bellocci – dont on reparlera, puisqu’elle participe à la master class qui donnera son dernier concert avec attribution des prix deux jours plus tard –, propose une Thétis de belle tenue. Mais celle qui triomphe ce soir est l’interprète du rôle de Cérès, Leonor Bonilla. Une beauté aux faux airs de Marion Cotillard et une élégance aristocratique sont ce qui caractérisent à la fois son apparence et son chant. Son grand air (qui n’est autre que le célèbre et pyrotechnique finale de Cenerentola) lui vaut un triomphe.

La Cambiale di matrimonio
Après la belle entrée en matière de la veille, on rempile le lendemain matin, vendredi 27, au Théâtre royal (Kurtheater) archicomble avec la Cambiale di matrimonio (Le Contrat de mariage), une farce qui est en fait le tout premier opéra proposé sur scène par Rossini (il avait déjà composé Demetrio e Polibio mais cette œuvre ne sera donnée à Rome qu’en 1812). C’est à Venise que l’opéra est créé en 1810 et le jeune auteur n’a alors que 18 ans ! Évidemment, la musique du compositeur en herbe n’atteint pas encore le génie des œuvres les plus connues, mais elle est tout à fait dans la norme de l’époque, truffée de citations et fort agréable à écouter. L’intrigue est sans surprises : une jeune fille est promise en mariage par son père au plus offrant, mais elle aime ailleurs et finira par obtenir le droit d’épouser l’heureux élu de son cœur.
Afin de pimenter un peu le tout, c’est à Lorenzo Regazzo qu’est confiée la mise en scène. Pour les habitués du festival, la basse bouffe vénitienne est l’un des atouts incontournables de la manifestation ; il est d’ailleurs sur l’affiche visible partout dans la petite ville thermale. L’année dernière, le chanteur/acteur s’était tout particulièrement illustré dans L’Occasione fa il ladro où il avait offert une prestation d’anthologie. Cette année, il ne chante plus mais joue le rôle d’un metteur en scène adepte convaincu de « Regietheater ». Dans cette astucieuse mise en abyme, on se moque des lectures excessives et inutilement conceptuelles ou contraignant l’œuvre à correspondre à la vision forcément hideuse et moderne du metteur en scène. Le résultat obtenu est curieux : la satire et la caricature, de grinçante et drôle, peut devenir une simple démonstration de Regietheater appliqué à l’opéra-bouffe. Autrement dit, on peut s’y amuser comme un petit fou en se riant des travers des directeurs ou se dire que ce que l’on voit, c’est précisément une de ces mises en scène tirées par les cheveux, hideuse et prétentieuse que l’on subit une fois encore… Le régisseur oblige donc ses comédiens à manipuler têtes de mort, détritus, tête de veaux et autres accessoires et costumes repoussants, prendre des poses alambiquées, alors que les comédiens ne rêvent que de Zeffirelli ou Visconti, dont les photos sont suspendues au mur et vénérées comme d’authentiques reliques. Certains (dans le public) rient jaune, d’autres s’esclaffent sans retenue, ravis de cet esprit d’auto-dérision et de toutes les questions qui sont abordées ici. Il faut voir Lorenzo Regazzo s’incruster et couper d’un « Nein, nein » une belle déclamation en italien du plus pur toscan, imposant sa diction à l’accent allemand à couper au couteau ponctué d’un « Wunderbar ! » et réitérer le complément sur l’italien à la française hoqueté par un chanteur humilié de s’abaisser à cette interprétation forcée. Peu à peu, après avoir tout subi ou essayé (y compris l’exercice du ventriloque), les chanteurs reprennent le dessus, avec notamment une désopilante parodie d’Eleonora Bellocci, encore elle, qui va imiter la gestuelle de Maria Callas dont on voit des photos en projection. Les gags se succèdent, d’un mauvais goût très sûr mais toujours juste et délicieusement décalé. Par exemple, le metteur en scène se trompe d’opéra et exhibe fièrement un foulard de soie (seta) sur lequel est imprimé une vue romantique de la Scala de Milan, pensant probablement diriger la Scala di seta… Il est vrai que les intrigues de ces deux œuvres sont quasiment interchangeables. Les chanteurs finissent par abattre cet impossible régisseur et les spectateurs hueront tout naturellement Lorenzo Regazzo aux saluts, sans qu’il soit possible de deviner s’ils se glissaient dans l’esprit du spectacle ou détestaient vraiment le parti pris. En fait, l’opéra-bouffe est tel succès qu’il sera donné une dernière fois le surlendemain, en matinée, en lieu et place du concert de chambre initialement annoncé.
On en aurait presque oublié de mentionner la qualité du chant, remarquable, avec mentions spéciales pour le ténor Xiang Su qui se bonifie d’année en année et l’inénarrable baryton Roberto Maietta. On peut toutefois reprocher aux chanteurs de pécher par orgueil. Le théâtre dispose d’une bonne acoustique, mais étant minuscule, inutile de forcer pour garantir une projection maximale. Las, aucun chanteur ne modère ses ardeurs, ce qui provoque des déferlantes de décibels à devenir sourd. C’est d’ailleurs, pour les deux salles du festival, le principal reproche qu’on entend de façon récurrente. Qu’à cela ne tienne, personne ne boude vraiment son plaisir et au moins, on se retrouve totalement immergé dans les spectacles, comme si on était soi-même sur scène…
Zelmira
En soirée, on poursuit à la Trinkhalle voisine avec le dernier opéra napolitain de Rossini, Zelmira, créé en 1822. L’opéra, en plus d’être une rareté, est d’une rare exigence vocale (ceci expliquant sans doute cela). Il est ici présenté en version de concert et enregistré pour l’édition future d’un CD. L’intrigue, complexe, est cependant facile à suivre dans les grandes lignes : Zelmira est accusée à tort du meurtre de son père, le roi de Lesbos, qui, en fait, est bien vivant et se cache pour mieux se protéger des usurpateurs du trône. Sa fille découvre la vérité par hasard et doit évidemment se taire ; menacée de toutes parts, elle est contrainte à se séparer de son enfant et est de surcroît soupçonnée de vouloir également se débarrasser de son époux, qui se détourne d’elle. Les fourbes seront finalement démasqués et tout rentrera dans l’ordre.
Dans cette œuvre où tout le monde est poussé dans ses derniers retranchements, on ne peut que saluer les prestations de l’ensemble de la distribution. Toujours aussi énergique, le chef invité Gianluigi Gelmetti, habitué de Pesaro, obtient des merveilles de délicatesse de son orchestre, dans le respect des voix, même si l’ardeur des musiciens contribue parfois à couvrir les chanteurs, pourtant parfaitement audibles. Les chœurs sont également impeccables et les solistes se tirent des chausse-trapes de l’œuvre avec brio. La soprano Silvia Dalla Benetta est à l’apogée de son art et l’on se souviendra avec beaucoup de nostalgie de la très grande sensibilité qui se dégage de la scène d’adieu avec son enfant, en particulier, ou les piani se déploient délicatement dans une douceur ineffable… Déclaré souffrant la veille et pourtant bien présent et alors parfaitement vaillant, Mert Süngü rempile ce soir en affrontant la périlleuse partition qui lui est attribuée et ses acrobatiques vocalises avec bravoure. Si la tension est palpable, le résultat n’en est que plus convaincant. Ce ténor est à suivre. Les autres artistes sont tout à fait à la hauteur, avec toutefois un petit bémol pour l’interprétation de Joshua Stewart en Antenore, le méchant de service, qu’il aborde avec une sorte de détachement et de décalage peu séduisants, du moins à notre goût. Il va cependant sans dire que le plaisir d’entendre une œuvre aussi rare dans ces conditions est tout de même un vrai bonheur.
Rossini & Co.
Ce samedi 28 s’ouvre en fin de matinée, dans un Kurtheater comble, par un moment très attendu et, cette année, privilégié. Les jeunes chanteurs de la master class de Lorenzo Regazzo s’adonnent au traditionnel récital de fin de cycle. Il y a quelques années, ce concert était parfois pénible à l’oreille et l’on s’y rendait avec angoisse : certains chanteurs à la technique hésitante et excessivement juvénile n’étaient pas encore à la hauteur des airs de bravoure dans lesquels ils se risquaient. Rien de tel cette fois où l’on retrouve d’ailleurs certains artistes de l’année précédente, qui se sont améliorés entretemps.
Comme toujours, deux prix sont attribués : celui de l’équipe et de l’intendant, Jochen Schönleber, et celui du public, en se fiant à l’applaudimètre. Le niveau étant particulièrement remarquable, on se dit, une fois les quinze airs terminés, que le choix va être très difficile. Si les progrès de Muriel Fankhauser auraient sans doute justifié qu’elle soit récompensée dans le périlleux air de la Sonnambula, si la virtuosité croissante du ténor Xiang Xu font regretter qu’il ne figure pas lui aussi au palmarès, si l’excellence du baryton-basse Yevgeniy Chainikov en faisait un excellent candidat, c’est finalement Elonora Bellocci qui décroche le gros lot (et la possibilité d’un futur engagement pour une production des années à venir). Il faut dire qu’elle décoiffe en comtesse de Folleville dans le Viaggio a Reims. La soprano a par ailleurs une approche très personnelle et volontaire du personnage, sans compter qu’elle se joue des difficultés vocales avec une facilité apparente qui frise l’impertinence.
La plupart des chanteurs affichent par ailleurs de belles qualités d’acteurs, ce qui est bien normal, puisqu’ils sont sous la coupe de Lorenzo Regazzo, dont on a déjà amplement vanté l’incroyable talent comique (et dramatique), qu’il sait visiblement transmettre et ce n’est pas là la moindre de ses qualités. Ainsi, on aurait aimé que le remarquable baryton Roberto Maietta gagne le prix du public, ce qui est impossible, puisqu’il l’avait gagné l’an passé. Javier Povedano, baryton basse aux faux airs et moustache de Max Linder, mérite également des éloges, tout comme Baurzhan Anderzhanov, dans le même registre vocal, qui propose de Don Giovanni une amusante version narcissique et décalée, préférant se regarder dans le miroir plutôt que de s’occuper de Zerline dans « La ci darem la mano », air par ailleurs bissé. C’est finalement la pétillante soprano Maria Rita Combatelli, au physique qui rappelle Natalie Wood, qui est élue prix du public, ce que personne ne conteste, au vu des amples moyens vocaux et de la maîtrise de jeu de la demoiselle.
Pour une fois, on sort de l’habituel répertoire qui s’étend de Mozart à Donizetti (d’ailleurs fort bien accompagné au piano par l’infatigable Gianluca Ascheri) avec une chanson napolitaine particulièrement de circonstance avec le soleil écrasant qui baigne le festival. Est-ce également un clin d’œil au tournesol qui est systématiquement offert à chaque soliste en guise de bouquet à la fin de chaque spectacle ? Toujours est-il que le récital se conclut avec un improbable « O sole mio » donné par Trois ténors qui en réalité ne sont que deux, accompagnés par l’impayable baryton Roberto Maietta. Le résultat est désopilant et sera repris par tous les chanteurs, dans une déferlante sonore où semble s’évacuer toute la tension du festival et l’enjeu du concert. Un peu plus tard, au cours de l’après-midi, on croise une bonne partie des artistes dans les bains et saunas…

Moïse et Pharaon
Le soir même, tout le monde se retrouve à la Trinkhalle pour un Moïse et Pharaon mis en scène par Jochen Schönleber. Rossini reprenait son Mosè in Egitto pour l’Opéra de Paris en 1827. Peu de décors, des projections d’images de déserts ou de catastrophes (pas toujours très visibles en raison de la scène assez basse de plafond), des costumes contemporains avec quelques éléments à l’antique, tels que les bijoux ; on se croirait davantage dans la bande de Gaza que dans l’Égypte pharaonique, mais le propos, éminemment politique, est clair. Diversement appréciée, la mise en scène assume cependant fièrement son esthétique fauchée, minimaliste, tendance Allemagne de l’Est. Ce qui distingue l’opéra français du xixe siècle, c’est évidemment le ballet, ici assuré par les choristes. Du coup, on se trouve avec une sorte de quadrille simplissime qui n’est pas sans rappeler le célèbre Bal des vampires de Roman Polanski. Même si les idées abondent, la sensation reste tout de même celle d’un : peut mieux faire (et les années précédentes l’avaient d’ailleurs largement démontré !).
Au niveau du chant, on est gâté. Superbe distribution pour quelques moments privilégiés, tel le duo d’amour entre Aménophis et Anai. Dommage que le français soit prononcé de façon tellement artificielle qu’il est difficilement compréhensible (les surtitres sont bienvenus). En Anai, Elisa Balbo rayonne et vient à bout aisément des difficultés de la partition, tout en imprimant le rôle d’un beau tempérament. En Aménophis, Randal Bills, fagoté comme un petit nazillon, réussit à faire oublier son apparence désagréable et grotesque pour magnifier son personnage, car le ténor a des moyens et une aisance dans la vocalise remarquables. Impériale, Silvia Dalla Benetta est aussi touchante que la veille et nous ravit de fioritures et ornementations raffinées. Les autres rôles sont à la hauteur des attentes, à commencer par le Moïse d’Alexey Birkus, tout en puissance sans nuances, le noble Pharaon de Luca Dall’Amico, tout en troubles et doutes suscitant une empathie inattendue, avec une mention spéciale pour Patrick Kabongo et Xiang Xu, à suivre tous les deux. Sous la battue de Fabrizio Maria Carminati, les Virtuosi Brunenses donnent une prestation de haute qualité (tout en assurant tous les soirs, pendant l’entracte, un petit hommage rossinien en quatuor doté d’une mandoline sur la terrasse, au milieu des festivaliers). Bien entendu, le spectacle est filmé et donnera lieu à un DVD.
L’equivoco stravagante
Ce dimanche 29 juillet marque la fin du festival et comme le veut la tradition, le dernier spectacle est donné au Kurtheater, plein comme d’habitude. On se réjouit de découvrir un opéra de jeunesse très rare de Rossini, L’equivoco stravagante (le Quiproquo extravagant) créé un an après la Cambiale di matrimonio, donc en 1811. L’intrigue est croustillante (quoi qu’attendue) : un père a trouvé pour sa fille un mari. Or, la jeunette aime ailleurs. Pour l’aider, on fera croire au fiancé qu’elle est en réalité un castrat. Le stratagème fonctionne, le fiancé se rétracte et les tourtereaux vont pouvoir convoler.
Las, cette farce comique est traitée par Jochen Schönleber en tant que telle : une grosse farce, façon Cage aux folles suspendue à un panzer écrasant tout sur son passage. On ne recule devant rien et tous les effets comiques sont appuyés, à commencer par des symboles sexuels bien explicites qui ne font que banaliser une vulgarité sans objet. Dommage, vraiment, car il ne manquait sans doute pas grand-chose pour que le spectacle soit aussi réussi que la Cambiale di matrimonio. Mais l’agitation incessante et un rien désordonnée finit par lasser, pour ne pas dire franchement accabler. Qui trop embrasse, mal étreint… On commence à se demander si la programmation n’était pas un tout petit peu trop lourde. Même l’orchestre dans la fosse donne des signes de fatigue. Heureusement, les chanteurs sont à leur aise vocalement, même si le volume sonore est toujours très intense. Eleonora Bellocci, comme tous les jours et sans doute forte de son prix de la veille, est à son meilleur, Sebastian Monti, l’un des trois ténors de la veille, tourbillonne et se montre solaire et Patrick Kabongo est à son meilleur.
Au terme du spectacle, malgré une pointe de déception qu’on a envie d’oublier et d’évacuer bien vite, on sort content, réjoui aussi de voir l’équipe rayonnante, tout heureuse que le live streaming se soit bien passé. Tout le monde se sépare à regret, avec l’espoir de se revoir dans un an : la 31e édition est en effet prévue du 11 au 28 juillet 2019. Avec un peu de chance, on y sera !