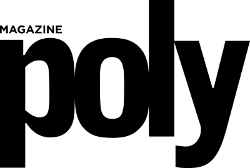Au Museum der Kulturen, Le Passage vers l’au-delà témoigne des différents rituels entourant la mort sur la planète.
Une pimpante maison en modèle réduit accueille le visiteur, qui comprend rapidement qu’il s’agit d’un… cercueil. Destinées à se concilier les bonnes grâces du défunt chez les Ga du Ghana, de telles pièces rappellent souvent le métier du disparu, permettant de prolonger son activité professionnelle. Voici donné le ton d’une exposition explorant les coutumes liées à la transition entre l’ici-bas et l’au-delà, tout autour de la Terre. Si l’accumulation d’objets – quelque deux cent cinquante, en totalité – peut impressionner, le parcours thématique (Le Début du voyage, Revenantes et revenants, etc.), intelligemment construit, est d’une grande fluidité, présentant autant d’artefacts que d’histoires. Certains sont proches de nous, comme cette civière de bois munie de rainures (permettant à l’eau de s’écouler) de la fin du XIXe siècle, utilisée par la communauté juive de Bienne pour la Tahara, le lavage rituel des morts. La plupart, néanmoins, viennent de mondes lointains, comme un Cycle de la mort réalisé dans les années 1980 par l’artiste péruvien Pedro Abilio Gonzales Flores : avec de petites figurines évoquant des santons, il retrace les étapes suivant un décès dans de séduisantes saynètes.
Passionnantes sont des sections dédiées au Bardo Thödol, livre des morts tibétain dont est notamment présenté un manuscrit – décrivant les états de conscience et les perceptions se succédant pendant la période allant du trépas à la renaissance – et à la purification des âmes à Bali, dans laquelle se découvre notamment une très impressionnante tour de crémation de plusieurs mètres de haut. Un riche détour est aussi fait par Bornéo, chez les Ngajus, où il est possible de tout apprendre (ou presque) de l’accompagnement des âmes qui doivent atteindre le Lewu Liau, un avatar du paradis où elles sont transportées sur le Banama Rohong, un bateau dont sont montrées plusieurs représentations. Plus familière, une immense peinture sur tissu réalisée à Ispahan vers 1900 figure tous les êtres humains comparaissent devant Dieu, attendant leur jugement… Avec ses dragons, serpents et autres scorpions, la représentation de l’enfer est un pur chef-d’œuvre ! Impossible d’évoquer ici l’intégralité des coutumes décrites, tant la présentation est riche, mais impossible aussi de ne pas parler de deux délicats bijoux d’or de quelques centimètres de haut (réalisés entre le Ier et le VIIe siècle) jouant un rôle essentiel dans la culture quimbaya (Colombie), anéantie par les colonisateurs espagnols : ces deux colibris, poétiques boussoles, ont pour fonction d’accompagner les hommes lors de leur passage vers le monde des ancêtres, les aidant à s’orienter.
Au Museum der Kulturen (Bâle) jusqu’au 26 avril 2026
mkb.ch