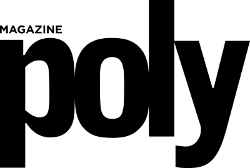Carl Schuch et la France permet la (re)découverte d’un peintre autrichien qui illumina le XIXe siècle grâce à son travail sur la couleur.
Mal connu, Carl Schuch (1846-1903) se place dans un espace esthétique situé entre les deux totems de la seconde partie du XIXe siècle, que sont réalisme et impressionnisme. Cherchant sans relâche une voie personnelle, il écrivait du reste, dans une lettre du 31 mai 1883 : « Je ne voudrais me rattacher à rien : ni à l’impressionnisme, ni à Leibl, ni à Daubigny, ni à Millet. Je voudrais pouvoir être sincère, être vrai, et ne pas avoir une relation à la nature comme Troyon, X ou Y. » À travers quelque soixante-dix de ses œuvres – conversant avec une cinquantaine de toiles d’artistes comme Chardin, Fantin-Latour, etc. –, cette riche exposition débute par un aperçu de la carrière d’un peintre voyageur – notamment installé à Venise de 1876 à 1882 – qui appartint au « Cercle de Leibl » constitué à Munich, au début de la décennie 1870, autour du célèbre artiste allemand, dont la figure tutélaire est Gustave Courbet. Se découvre ainsi l’amitiéentre Schuch et Wilhelm Trübner (1851-1917) : la comparaison entre leurs représentations respectives d’un jeune homme farfouillant dans une armoire pour en extraire une bouteille de gnole (Le premier essai, 1872) révèle leur parenté.



C’est néanmoins la seconde partie du parcours qui retient le plus l’attention. Se concentrant sur les « années parisiennes » (1882-1894) de Carl Schuch, elle se déploie en cinq salles thématiques, où l’on voit son style se libérer, s’ouvrant aux avant-gardes d’alors, lui qui considérait Monet comme le « Rembrandt de la lumière en plein air. » Il réalise alors de nombreuses natures mortes, explorant les potentialités de la couleur. Le très beau Homard, cruche en étain et botte d’asperges (1884) – une des quatre représentations de la plante – dialogue avec une incroyable huile de Manet (1880), qui en constitue la matrice. Et de demeurer fascinés par la quête chromatique du peintre autrichien qui atteint de subtils équilibres comme dans Courges, pêches et raisins (vers 1884-97), avec ses contrastes audacieux entre oranges chauds et bleus glacés. Parfois, il est aussi difficile de ne pas penser à Cézanne, comme dans trois variations autour de pommes posées sur une nappe blanche… Le visiteur est également séduit par des paysages comme Bois de bouleaux (1880) – composition architecturée avec une rigueur rare – ou Cœur de la forêt au Saut du Doubs (vers 1886-93) – où la lumière subit un fabuleux processus de concentration – montrant son amour pour une région dont il restitue l’âme avec brio, celle où il passa plusieurs étés et où naquit Courbet dont l’ombre amicale flotte sur ces vues.
Au Städel Museum (Francfort-sur-le-Main) jusqu’au 1er février 2026
staedelmuseum.de