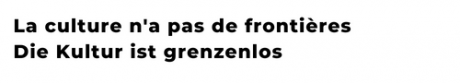Grand copain de Matthieu Cruciani qui lui a passé commande du texte de sa prochaine pièce, Piscine(s), François Bégaudeau se prête sans fard à l’art de l’entretien. Preuve que ce grand contempteur du système politico-médiatique sait, aussi, se poser.
Vous débordez d’activités : roman, cinéma, critique, télévision, débat, polémiste face à Raphaël Enthoven… Pour en faire autant, n’avez-vous pas la peur du vide ?
Je sépare l’activité artistique de production de textes où on pourrait se demander psychologiquement ce qui fait que je sois tout le temps en train de bosser. La réponse est bien connue : une espèce d’angoisse que j’ai depuis très longtemps et qui est assez commune à un tas d’artistes. Les produits dérivés, c’est autre chose. Quand tu te retrouves dans la médiatisation ou le SAV des bouquins qui consiste à aller à la TV et la radio, franchement je m’en passerais bien ! Si un génie m’apparaissait et me disait : dans 10 ans tu n’auras plus besoin de le faire d’aucune manière, ce serait parfait car je ne suis jamais content d’y aller ! Mais cela fait partie du business économique. On sait que ces passages médiatiques font connaître ton travail, permettent d’en vendre et de se stabiliser économiquement. Il se trouve qu’avec Histoire de ta bêtise cette année, livre conflictuel, il y a eu des moments plus tendus car les gens qui me recevaient étaient les premiers concernés par ce que je racontais dans le bouquin, ce qui a créé des choses étranges qui n’ont pas duré longtemps car très vite je n’ai plus été invité.
Vous vous doutiez que ce grand coup de pied dans la fourmilière allait à ce point agiter le landerneau journalistique ?
Pas à ce point-là, non. À chaque fois que j’écris un livre, j’ai l’impression que personne ne va le lire, ce qui ne m’est pas toujours arrivé puisque certains se sont très bien vendus. Mais j’ai cette espèce d’irresponsabilité de me dire qu’ils se noient dans les librairies et les bibliothèques.
En même temps votre attaque était frontale…
Je ne pensais sincèrement pas qu’il serait aussi visible. Pour qu’on voit que l’attaque est frontale il faut qu’il ne passe pas inaperçu, ce qui n’est jamais gagné. Je savais bien que lorsque les journalistes le liraient, eux qui sont les premiers concernés par ce que j’y dénonce, ce ne serait pas un lit bordé de roses. Cela m’a plutôt amusé car c’était un prolongement parfait du livre, l’illustration de ce que je démontrais : leur radicalisation, leur raidissement idéologiquement et leur droitisation, leur embourgeoisement.
Dans Tu seras écrivain mon fils, vous dites que pour réaliser son grand œuvre, il faut se consacrer pleinement à l’écriture. Pourquoi vous en détournez-vous autant ?
Si tu passes ta vie à la télé, bien sûr que ça te détourne de l’essentiel du travail d’écriture. Mais est-ce un éparpillement de faire à la fois du roman, du théâtre, des scénarios, de la BD ? Je ne crois pas car tout profite à tout. Avoir travaillé dans le théâtre depuis 10 ans a par exemple affiné mon écriture de romancier. Il faut trouver le temps, que son corps ait les ressources énergétiques pour mener tout cela de front, une question qui se pose tous les jours. Le roman reste mon activité principale. Il faut garder dans sa vie deux mois où ne travailler que sur un roman. C’est le gros boulot de départ, après pendant un an tu repasses dessus. Tant que je peux m’aménager cela, tout ira bien. Le reste…

Qu’avez-vous cherché dans le théâtre que vous ne trouviez pas ailleurs ?
En fait, le théâtre m’a trouvé sans que je le cherche. J’ai eu de la chance au départ. J’y allais un peu et lisais le patrimoine au sens large, de Sophocle à Lagarce. J’adore en lire et me suis passionné pour Beckett, Racine et le XVIIe ce qui parait toujours très bizarre, puis Brecht, Tchekhov… Très banal et standard en fait ! Les circonstances ont fait qu’une amie comédienne m’avait demandé une pièce et qu’Arnaud Meunier est tombé dessus car elle avait été éditée par Théâtre ouvert (Le Problème, 2008). Il m’appelle sans qu’on se connaisse et il s’entoure de grands comédiens : Jacques Bonnaffé et Emmanuelle Devos, une grande aide pour monter la production. Coup de bol de départ car il est extrêmement rare pour un auteur de trouver tout de suite quelqu’un pour monter son premier texte. De fil en aiguille j’ai rencontré Matthieu Cruciani, Benoît Lambert et j’ai toujours eu des pièces à écrire. Je suis un privilégié !
Cette chance d’être au bon endroit au bon moment, c’est aussi le cas avec Entre les murs. Le cinéma a joué ce rôle d’éclairage avec l’adaptation de votre roman et votre rôle dans le film qui reçoit la Palme d’or à Cannes ? Ça aide ou ça cloisonne ?
Le livre s’est beaucoup vendu à sa sortie et le film l’a fait revendre. C’est le roman qui m’impose sur la scène éditoriale et qui fait que mon nom est inscrit sur la carte. Cela stabilise ton existence économique. Tu sais que tu as un petit vivier de lecteurs même si ce n’est pas une garantie : 200 000 ventes d’Entre les murs n’ont pas profité à celui d’après qui a plutôt fait un bide alors que je l’aime bien (Fin de l’histoire, Éditions Verticales, 2007). Une carrière de romancier est en zigzag, c’est toujours compliqué, rien n’est sûr. Mais être connu reste un énorme bénéfice. L’écueil, qui est bien moindre, est que ça t’étiquette un peu “auteur social” ou qui parle de la jeunesse. On te demande un peu toujours les même travaux. Alors que pour toi, ce n’était qu’un livre parmi d’autres.
En même temps auteur social est une case assez vaste pour être assumée…
Oui ça va, même si j’ai fait beaucoup de choses qui n’ont pas à voir avec la saisie sociale de la société. Il ne faut pas qu’on te demande de faire des pièces ou livres d’édification morale, un peu sympathoche, d’être un artiste grand frère qui va créer du lien social. J’ai eu ce genre de sollicitations dont je me suis sorti très vite. J’ai même reçu trois ou quatre scénarios pour jouer des rôles d’éducateur social dans un quartier, du genre de Toledano et Nakache ! J’ai refusé tout ça, je suis un mec beaucoup plus conflictuel que ça, beaucoup plus emmerdeur et pas du tout dans la morale.
Ce côté engagé, aimant l’empoigne et les joutes comme récemment avec Raphaël Enthoven où vous avez manié tous les deux les coups bas et les attaques, comment est-il reçu dans le milieu littéraire français plutôt policé ?
Histoire de ta bêtise fait le bilan de 10 ans de vie dans ce milieu culturel bourgeois. J’y écris : « Avec toi, je n’ai pas donné suite. » J’y tutoie mon bourgeois et c’est vrai, je constate que ça n’a pas fonctionné. Je m’y suis fait des amis et réussis à bosser. Gallimard, auquel appartiennent les Éditions Verticales, m’accueille dans ses murs. Je n’ai pas à me plaindre, on ne m’a pas dit que j’étais trop punk. Globalement ça va mais il y a un hiatus. Je ne me sens pas de ce milieu et quelque chose chez moi les exaspère…
Est-ce votre milieu d’origine ou votre positionnement politique ?
Je suis un petit bourgeois fils de profs, donc totalement soluble dans la bourgeoisie parisienne qui est très assimilationniste. À partir du moment où tu arrives avec un petit succès, tu as une valeur marchande qui les intéresse et ils sont tout à fait prêts à t’accueillir. Maintenant tu es des nôtres, on va t’inviter dans les diners et on va devenir copains. Ça se serait très bien passé si je n’avais ce vieux machin punkoïde-anarchiste gnagnagna qui fait que leurs diners ne m’amusent pas et qu’en fait, ça ne va pas le faire. A fortiori quand j’apparais sur la place publique comme un type de gauche radicale, cela solde l’affaire. Ce en quoi ils n’ont pas tort puisque je n’arrête pas de dire du mal d’eux.

Matthieu Cruciani vous a commandé le texte de sa prochaine création. Vous avez vu ensemble The Swimmer, le film adapté de la nouvelle de John Cheever, idolâtré par Hemingway et Philip Roth. Un simple point de départ ?
Ma pièce en est finalement loin en effet car le milieu dépeint par Cheever évoque les années 1950 américaines et une certaine bourgeoisie très éloignée de nous. J’ai tout de suite dit à Matthieu qu’il nous fallait revoir l’ensemble pour être en miroir de nous, en 2010. Chez Cheever, on picole autour des piscines dans une sorte de décadence un peu vulgaire. Je voulais plutôt parler de la bourgeoisie macronienne, qui bosse en start-up et ne boit pas, sauf de bonnes bouteilles dans les caves à vin. Je n’ai gardé que le personnage central, Ned, qui est passionnant et devient Paul. L’environnement autour c’est moi, c’est Matthieu et les autres car nous sommes pris malgré nous dans les mêmes espaces de vie. On a ce corps contemporain cool, flottant, technologisé, élégant. Pas une satire, un vrai miroir.
Piscine(s) sera un grand écart entre Gatsby le magnifique et Vernon Subutex ?
Oui ! Mais ce segment sociologique n’a pas tant que ça été décrit. Je remet à jour ce qu’est l’homme moyen aujourd’hui, le citoyen incarnant l’époque. C’est pour cela que je me regarde pour voir où j’en suis avec mes contradictions, pour faire des constats : je déteste Facebook mais je l’utilise, je sais qu’un smartphone est redoutable mais j’en ai un dans la poche, je ne suis pas très libéral politiquement mais je suis un individu physiquement libéral. Et j’en suis partie prenante. J’ai un laptop Apple, je suis pris dans le flux. Ce mot a très vite été pour moi une indication politique, thématique et théâtrale.
Dans ce flux, une rupture apparaît : le langage de Paul. Comment est venue cette manière de parler, liée à la nature, à nos racines terriennes et métaphysiques, qui dénote totalement, surprend et désarçonne au milieu du reste ?
C’est ce qu’il reste de Cheever. Ce personnage arrive comme une espèce de néo-homme primitif, une figure christique ou toute une généalogie de prophète auto-proclamé, ce qui crée le pathétique du personnage. Il est à la fois sublime et pathétique, celui qui vient dire au monde “votre vérité vous échappe, je vais vous la dire”, est lui-même dans le déni de ses propres actes passés et de son présent. Totalement paradoxal et troué. En même temps il dit des trucs que j’ai beaucoup aimé écrire. Cela fait monter un peu la langue, et j’ai cette passion pour un certain lyrisme littéraire. J’aime faire dissoner le langage. Les autres personnages sont choqués par ses mots et j’espère bien que les spectateurs le seront un peu aussi. Il a une certaine folie, comme s’il avait avalé un Chateaubriand.
Une amie de sa fille lui dit qu’il a “la logique des fous”. Insupportable d’écouter ce qu’il dit mais personne ne peut véritablement s’en empêcher…
Mon pari reste que quelque chose puisse s’y entendre. Les comédiens me demandent souvent si je pense ce que je fais dire à leur personnage. Je réponds que lorsque j’écris du théâtre, je ne me pose jamais cette question. Par contre ce sont toujours des trucs qui m’intéressent. Paul dit des tas de choses dotée d’un petit fond nietzschéen que je peux avoir. Son inquiétude devant la dévitalisation générale de ce qu’il appelle le dernier homme, c’est Paul. Ne serait-on pas tous exsangues, plongés dans une mollesse globale très émolliente et cotonneuse ? Mais aussi très agréable car les espaces de vie libéraux des gagnants de la société sont très confortables. Mais n’est-ce pas en train de m’anesthésier ?

Vous lui offrez un destin low-cost, formant un anti-héros tragique continuant à faire comme si…
C’est commun à tous les grands prophètes. Le Christ est un grand lucide et un grand malade en même temps. On ne sait s’il n’est pas en train de faire un dernier monologue avant de s’effondrer. Paul a une sorte de verticalité qui est proche du délire. Créer un texte sans jamais savoir si c’est une parole de vérité très autoritaire et respectable ou la parole d’un taré proche du stade terminal le rend très intéressant. On est dans un vieux motif de l’hubris, de l’orgueil d’Œdipe, de voir sa vérité en face. Plus il y va, plus il découvre à quel point il est le coupable ou l’homme faible. Ce sont des espaces de jeu superbes…
L’absence de temporalité de la pièce, dont on ne sait si elle dure 1 semaine, 1 mois ou 1 an – voire si tout cela a vraiment lieu ou n’est que le délire de Paul pour s’en sortir en continuant à donner le change pour jouer le jeu de la société – se double d’une absence d’aide. Aucun de ses amis ne viendra le sauver. Une forme de critique sociale : lorsque tu tombes, les autres regardent ta chute ?
J’espère bien qu’on va l’interpréter comme ça : de la promptitude de cette classe sociale à exclure les moutons noirs. Ce groupe a anthropologiquement besoin de ça et on les comprend presque. Matthieu Cruciani adore cette ambivalence et cette complexité.
Vous inventez aussi L’homme-femme à chemise Hawaï, personnage qui n’en est pas un : plutôt un double de la conscience de Paul. Jouissif à écrire ?
Très jouissif. On se fait plaisir à écrire ces monologues comme dans les romans de Gombrowicz. C’est aussi appétissant pour les acteurs ou actrices à jouer. Il y a de la fantaisie mais avec de la profondeur. Fondamentalement, il y a une question sur le statut ontologique de ce qu’on voit. Tout cela ne serait-il pas qu’un rêve de Paul ? Ce qu’il appelle des souvenirs ne seraient-ils pas des fantasmes ?
> Vraie-fausse conférence « François Bégaudeau, pourquoi n’avez-vous pas le succès que vous méritez ? », à la Comédie de Colmar, vendredi 22 et samedi 23 novembre en partenariat avec le Festival du Livre de Colmar
festivaldulivre.colmar.fr
> Au Parc des Expositions le festival accueille Agnès Ledig, Catel, David Sala, Fatou Diome, Harlan Coben, Marie Desplechin, Yasmina Khadra ou encore Ian Manook, samedi 23 et dimanche 24 novembre
> Piscine(s), créée par Matthieu Cruciani à la Comédie de Colmar, du 21 au 30 janvier 2020
comedie-colmar.com
> Puis en tournée au Théâtre Dijon Bourgogne, du 5 au 7 février 2020
tdb-cdn.com
> À La Filature (Mulhouse), mardi 12 et mercredi 13 mai 2020
lafilature.org
> À La Comédie de Reims, mercredi 27 et jeudi 28 mai 2020
lacomediedereims.fr