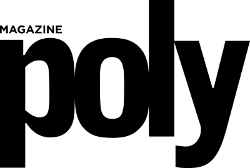Rachid Bouali se remémore son histoire algérienne
Avec On n’a pas pris le temps de se dire au revoir, Rachid Bouali raconte une double disparition : celle du quartier de son enfance et celle de son père, mémoire de son histoire algérienne.
En 2023, le quartier de la Lionderie, à Hem, dans le nord de la France, est détruit. Au même moment, votre père s’en va. Comment liez-vous ces deux événements sur scène ?
Au début, il est à l’hôpital, mais c’est très ambigu, je me suis amusé à brouiller les pistes. Dans la vraie vie, il se trouvait à Roubaix, à six kilomètres de chez nous, donc on ne pouvait pas entendre les bulldozers. Là, je voulais les rapprocher. En bande-son, on perçoit les pelleteuses et marteaux-piqueurs. Je commence à décrire la destruction du quartier, faisant vite comprendre qu’il est à l’hôpital. Je pense que la nécessité d’écrire ce spectacle a été déclenchée par son décès. Ma mère était déjà partie, je me dis que je n’ai plus de passé, mes parents ne sont plus là pour raconter leur quotidien en Algérie, le Code de l’Indigénat, l’Algérie française. Ce n’est pas tant une revendication, mais c’était important de raconter l’histoire vécue dans l’intimité d’une famille.
À certains moments, vous interprétez votre propre père. Le faites-vous avec d’autres personnages ?
Je le fais avec ma sœur, même si elle est très peu présente. Je le fais aussi avec ma mère, qui essaie de m’aider à faire mes devoirs et qui, comme on dit, parle français comme une vache espagnole. Quand ta mère, qui ne vient jamais à l’école, qui ne sait pas écrire, qui ne parle que le berbère et un peu le français te dit qu’elle va t’aider, ça donne une scène comique. En même temps, cela permet de montrer que ce n’est pas simple. Si l’on veut être unis, ensemble, sur le territoire français, il y a des familles qu’il faut vraiment aider.
Les décors sont très minimalistes. Pourquoi ce choix ?
Je suis un conteur, donc j’aime évoquer des choses. On a travaillé une scénographie de lumières avec énormément de découpes, des rectangles un peu partout suggérant des espaces, des lieux, des gens différents. L’idée était de créer une grammaire pour parler d’une identité éclatée, de morceler les différentes étapes de ma vie. Un coup, je suis dans le quartier, je fais un voisin dans un carré, d’autres fois, un rectangle représente une classe d’école et devient une tranchée de la guerre 1914-1918.
Vous avez parlé du son des outils de chantier que l’on peut entendre. Y a-t-il d’autres enregistrements surgis de votre passé ?
Il y a des voix d’enfants, qui ne viennent pas de mon passé, mais d’un atelier que j’ai fait avec des élèves allophones à Chevilly-Larue, en banlieue parisienne. On leur avait demandé s’ils connaissaient des comptines traditionnelles, et trois arabophones m’en ont chanté une. Quand j’ai écrit le spectacle, j’ai décidé de la mettre un peu après la scène où le prof parle de la guerre de 1914-1918 et de nos aïeux. Il y a aussi Étincelle du joueur de luth tunisien Anouar Brahem. Il y a quelque chose de mystérieux, d’étrange dans sa musique. La chanson arrive au milieu de lumières orange suggérant le village de mes ancêtres.
Au Théâtre de la Manufacture (Nancy) du 13 au 15 mai
theatre-manufacture.fr