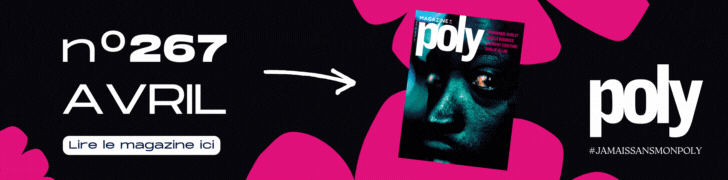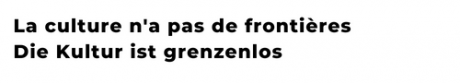Le dico du rock
Véritable encyclopédie musicale, le journaliste et écrivain Michka Assayas a dirigé la rédaction du volumineux Dictionnaire du rock. Ce fan de Dylan, des Beatles ou de Joy Division continue d’avoir un rapport maladif avec le rock actuel qu’il défendait tous les dimanches soirs sur France Musique dans l’émission Subjectif 21). Même si, aujourd’hui, il peine à écouter un disque en entier…
Vous avez découvert la musique grâce à votre frère, le cinéaste Olivier Assayas, avec lequel vous avez entamé une collection depuis 1960. Où en est-elle ?
La collection de vinyles est chez moi. Nous l’avons partagée jusqu’en 1985, lorsque nous avons cessé de vivre ensemble. Le CD a pris le relais, mais il n’a pas la même magie. Son arrivée a correspondu à une perte d’intensité dans la musique. Bien sûr, il y a eu des groupes comme Nirvana ou Radiohead qui m’ont beaucoup marqués, mais j’avais plus de trente ans et l’essentiel s’était déjà joué pour moi.
Que représentait le rock pour l’ado studieux que vous étiez ? Un peu de sexe, de drogue et de rock & roll dans un monde de cahiers d’école et de stylos à encre ?
C’était lié à l’ennui car je vivais dans un bled pas très loin de Paris, mais éloigné culturellement. Pas de télé, des stations de radio diffusant des chansons “rive gauche”… Le rock représentait une autre vie, loin des études, de la société, des traditions. Tout ça s’est mélangé avec Mai 68 et les manifestations gauchistes. J’étais jeune, mais espérais le grand chambardement. Il y avait quelque chose de prophétique dans la musique : j’attendais qu’elle anticipe ce que le monde allait devenir. Quand le punk est arrivé, je me suis rendu compte que la révolution n’allait jamais avoir lieu. Les Beatles, Bob Dylan, Roxy Music, King Crimson, John Cale, puis les Sex Pistols, Devo, B-52’s ou les Clash ont accompagné mes illusions et mes désillusions.
Vous parlez de vous comme d’un “accumulateur compulsif”. Êtes-vous toujours victime de cette pathologie ?
Oui, c’est difficile de l’éradiquer car j’ai été encyclopédiste avant de l’être professionnellement. J’ai gardé beaucoup de documents, des journaux, des numéros du New Musical Express… J’ai entassé des 45 tours. Je suis de la génération de “l’archivisme”. Je savais que tout ce qui avait trait à cette musique allait devenir essentiel. C’était avant Internet et tout ça risquait de s’éparpiller, de disparaître. Alors j’ai constitué une sorte de caverne d’Ali Baba. Aujourd’hui, tout est immatériel, mais je vais toujours à la recherche d’artistes sur des sites de streaming et suis capable de rester trois heures chez Rough Trade à Londres. J’ai cette appréhension de passer à côté. Je ne guérirai jamais.
En écrivant pour Actuel, Les Inrocks ou Rock&Folk, que cherchiez-vous à exprimer ?
À 21 ans, je ne savais pas quoi faire après mes études de Lettres. Mon frère m’a poussé à contacter Rock&Folk et, à ma grande stupéfaction, ça a marché. J’étais très militant : je voulais parler de Joy Division, d’Echo and The Bunnymen ou de Gang of Four en France. Il y avait une vitalité existentielle chez eux et j’avais un combat à mener !
Et que retenez-vous des années 1990 ?
J’ai connu le choc du double blanc des Beatles et de l’album des Sex Pistols et là, une autre histoire commençait. J’aurais pu écouter de la house, aller dans des raves un sifflet autour du cou, mais j’avais l’impression d’avoir déjà fait un tour de cadran.
Vous prétendez ne pas écouter d’albums actuels en entier…
Qui, aujourd’hui, écoute un album de bout en bout, un même artiste durant plus de 35 minutes ?
Est-ce dû à la dictature du single et la surabondance de sorties ?
Sans doute…
Vous offusquez-vous de notre époque qui recycle beaucoup ?
Imiter les anciens, ça a toujours existé. L’Illiade et L’Odyssée ont été copiés, la peinture italienne de la Renaissance aussi… Si vous parlez des Beatles à un musicologue savant, il vous énumérera les emprunts à la musique baroque ou romantique. Ceux qui ont le monopole du discours sur la musique sont là pour ramener leur science et faire référence aux groupes du passé, mais on ne peut pas réinventer la roue à chaque fois.
Comment avoir un propos original ?
Il faudrait créer avec une nouvelle pauvreté. Ce qui est stimulant en art, c’est la contrainte et les limites. C’est paradoxal, mais nous avons trop de possibilités, trop de matériel, trop de logiciels…
Et la musique est très vite digérée…
Il faut lutter contre l’insignifiance. La musique est considérée comme un accompagnement apportant du bien être. On cherche à la placer partout, dans les pubs, les magasins… Elle est devenue décorative et s’autodétruit rapidement. Elle n’a pas le temps d’entrer dans le cœur des gens.
Selon vous, le rock, c’est « un mélange de naïveté, de mégalomanie, d’idéalisme, de mysticisme et, parfois, de folie ». Une bonne définition ?
Le premier cri est important. Il faut faire comme si c’était la première fois.