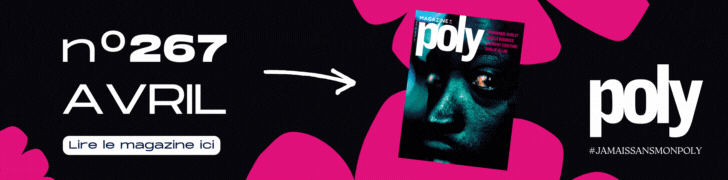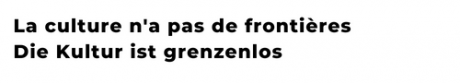Le feu sacré
Chant posé en arabe, en anglais ou en français et notes pianotées, musiques du Moyen-Orient et beats électroniques : le parisien d’origine libanaise Bachar Mar-Khalifé, auteur d’un troisième album nommé Ya Balad (Ô pays), convoque Fairuz, Gainsbourg et le dub en des morceaux où il est question de filiation et de fusion.
Vous revenez tout juste du Liban ?
Oui, je suis rentré dans la nuit, il y a quelques heures, et je m’apprête à repartir pour le Maroc où je donne une série de cinq concerts en piano solo. J’essaye d’aller une fois par an au Liban, avec les enfants, pour voir la famille. C’est une piqure de rappel et une découverte à chaque fois car tout bouge tellement vite. On en revient toujours transformé, avec une nouvelle énergie qui se traduit musicalement.
Qu’est-ce que vous y retrouvez ?
L’hospitalité. Les gens ont un rapport aux autres très différent de l’Occident. Il y a un certain respect entre les différentes classes sociales. Bien sûr, il y a aussi des choses à déplorer : l’absence de conscience écologique, la corruption, le béton qui réduit sans cesse les espaces naturels…
La comédienne Golshifteh Farahani (héroïne du dernier Jarmusch) chante sur votre morceau Yalla Tnam Nada. Dans Les Deux amis de Louis Garrel, son cœur balance entre deux amours : vous sentez-vous comme Golshifteh dans le film, tiraillé entre votre pays natal et celui où vous avez fait votre vie ?
Il ne s’agit pas d’un tiraillement, car je n’ai pas à choisir, mais d’un parcours de vie : né à Beyrouth pendant la guerre, je me suis installé en France à l’âge de six ans. J’ai grandi ici sachant que je venais de là-bas. Mes deux cultures ne se mélangent pas, mais sont en moi. Je me suis demandé, à une période, si je n’allais pas m’installer au Liban, mais aujourd’hui je suis serein par rapport à ça…
Il est cependant question de déchirement dans vos morceaux. Dors mon gâs(e), par exemple, est une berceuse chantée par un père appréhendant le jour où son enfant quittera le nid familial…
C’est sûr que la séparation est douloureuse et tumultueuse, mais je me focalise davantage sur ce que je gagne plutôt que sur ce que je perds. La berceuse est de Théodore Botrel, en 1922 : elle montre que le sujet de la mort rôde souvent autour de l’enfance. C’est le cycle de la vie. Je trouve que cette chanson est d’actualité avec tous ces gens qui quittent leur pays et partent en mer pour tenter de s’en sortir.
Le sacré irrigue votre Requiem et autres chants à la semblance de prières comme Madonna…
Faire de la musique, c’est croire en des instants de communion éphémères qui nous extraient du quotidien. Ces moments sont sacrés. Nous sommes tous asservis et pour échapper à ça, il y a la musique, une porte permettant aux hommes d’aller vers l’inexplicable, les forces naturelles qui nous ont inspirés des notes, des fréquences…
La musique est-elle le dernier espace où les frontières sont abolies ?
Elle n’admet pas les limites. Partout dans le monde, on retrouve les mêmes tonalités, instruments et chansons. La censure n’a jamais eu raison de la musique qui trouve toujours un moyen pour s’exprimer.
Ell3, duo instrumental entre un mélodica et un piano, est une douce composition minimaliste, un dialogue amoureux. Mais pourquoi le 3 à la fin du titre ?
On ne m’a jamais posé cette question [il réfléchit]… Il s’agit d’un dialogue entre deux personnes qui en créent une troisième. Je préfère dire “1 + 1 = 3” que “1 + 1 = 2” [rires].
Votre musique s’adresse au cœur, à l’esprit et aux jambes. Tout le corps est concerné…
Au début, j’avais tendance à trop intellectualiser les choses et à négliger le corps. J’ai appris que c’était une erreur car tout est lié, qu’on pleure ou qu’on danse. Durant mes concerts, je dois réconcilier tout le monde et essayer de faire danser ceux qui pensaient rester assis et faire pleurer les danseurs [rires].
Dans le clip de Layla, vous brisez votre piano. Pourquoi le malmener, l’éventrer et mettre ses tripes à l’air ?
En effet, quelque part, je donne vie à une machine. Je détruis quelque chose de sacré : l’instrument roi sur lequel on joue religieusement du Chopin. Je casse cette image figée dans ce geste. Il faut être en conflit avec son piano, il est nécessaire de le libérer, comme John Cage l’a fait en jetant des balles de ping-pong sur ses cordes. On cherche à tout prix à archiver, conserver les choses, alors que brûler une lettre, par exemple, c’est l’envoyer ailleurs…
À La Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette), mardi 21 mars À La Philharmonie de Paris, vendredi 5 mai (Bachar et son frère Rami – du groupe Aufgang – accompagnent leur père, Marcel Khalifé, célèbre oudiste et compositeur libanais)
Ya Balad, édité par InFiné
© Joachim Olaya et David Normant