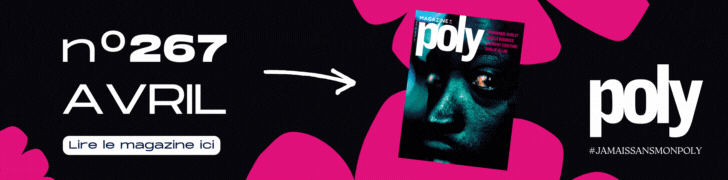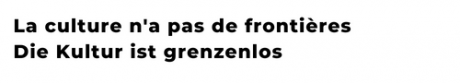Métamorphosé en véritable cité des images, le Schaulager consacre une impressionnante exposition monographique au vidéaste et cinéaste britannique Steve McQueen. Entre engagement politique et échappées poétiques, visite d’un édifice artistique complexe, radical et passionnant.
Steve McQueen (né en 1969) est connu du grand public – toute question d’homonymie mise à part – pour avoir réalisé deux des films les plus marquants de ces dernières années, révélant au passage le talent de Michael Fassbender : Hunger (2008, récompensé par la Caméra d’or au festival de Cannes) et Shame (2011). Le premier narre le calvaire de Bobby Sands, militant de l’IRA mort en prison après une grève de la faim. Le second est une plongée hallucinante au cœur de l’existence d’un sex addict new-yorkais. Mais ces incursions dans un mode d’expression d’essence mainstream – avec la radicalité du rapport au corps pour dénominateur commun – ne sont que la partie émergée d’un énorme iceberg artistique.

La cité du cinéma Plus de vingt vidéos (d’une durée totale de six heures et quelque) et installations, des photographies et d’autres pièces (comme Queen and country, étonnant cabinet de chêne renfermant 160 planches de faux timbres) forment la plus complète exposition jamais dédiée à ce plasticien… qui renvoie son interlocuteur dans les cordes lorsqu’on lui parle du choix de la vidéo comme vecteur artistique principal. « Que ce soit un pinceau, de l’argile, de l’acier ou une caméra, peu importe. Je ne m’intéresse pas au medium lui-même, mais au monde qui se trouve devant moi », explique-t-il, se comparant à « un chasseur de papillons tentant d’attraper quelque chose dans son filet ». Steve McQueen n’est guère loquace. Pas envie de gloser, d’expliquer pourquoi, pour un projet déterminé, il choisit telle ou telle caméra : « C’est très intéressant, mais c’est en même temps très ennuyeux. » Ses œuvres parlent, il est vrai, d’elles-mêmes, installées dans un Schaulager complètement remodelé, devenu une véritable ville du cinéma, dont l’antichambre est Static (2009). Projetée dans la dernière salle éclairée par la lumière du jour avant une plongée dans la pénombre, cette vidéo ressemble, pour paraphraser Franz Liszt, à « une sorte de formule magique qui prépare, à l’image d’une initiation mystérieuse, nos âmes à la vision de choses inhabituelles et dépassant les perceptions de notre vie terrestre ». Pendant sept minutes, une caméra installée dans un hélicoptère tournant en rond autour de la Statue de la Liberté filme, dans un effroyable vacarme mécanique, son environnement. NYC nous apparait comme on ne l’imaginait pas, la gigantesque création de Bartholdi également : la perception brouillée, les sens bouleversés, le visiteur peut alors pénétrer dans l’obscurité et déambuler de salles de projection – aux couloirs d’accès parfois alambiqués – en places publiques illuminées par les images du plasticien. S’y trouvent plusieurs allers-retours avec le septième art, que ce soit Deadpan (1997), une référence à un film de Buster Keaton, ou Charlotte (2004), vidéo totalement rouge, métaphore des potentialités de la manipulation visuelle où l’œil de Charlotte Rampling fait écho à la célèbre scène du Chien andalou de Buñuel.

Engagement poétique Si l’on devait dégager les thèmes centraux de la création de Steve McQueen – qui s’y refuse affirmant au journaliste penaud qu’il est plus doué que lui pour cela – il faudrait évidemment mentionner un rapport physique à l’œuvre, comme dans Pursuit (2005), incroyable installation faite de points lumineux et de miroirs. Plus important semble cependant être un onirisme politique : si les thèmes choisis sont graves (exploitation économique de l’Afrique, paranoïa anti-communiste dans les années 1960, esclavage…), le traitement demeure pétri d’une intense poésie. Dans Giardini (2009), il nous entraîne ainsi sur le site de la Biennale de Venise, hors saison. Tout semble en déliquescence. Vide. La nature reprend ses droits et le Microcosmos est filmé en gros plan. D’étranges lévriers errent, nonchalants. L’œil saisit de clandestines étreintes masculines. Les pavillons nationaux, où sont présentés les artistes pendant l’événement, donnent le sentiment d’être délabrés : « L’endroit ressemble à un cimetière abandonné. Ces lieux, hymnes à la fierté des nations, n’ont plus que l’apparence de ruines. » Mais l’œuvre la plus saisissante – avec Queen and country, vaste sépulcre de bois rempli de timbres représentant des soldats britanniques tombés en Irak – est Lynching Tree (2013), créé spécialement pour l’exposition. L’image est fixe. Un arbre. De la terre. Nous sommes près de la Nouvelle-Orléans et l’endroit servit à pendre des esclaves. Autour de lui, de multiples tombes. L’histoire tragique du lieu semble concentrée dans cette photographie et nous arriver en plein visage, comme si les événements du passé se cristallisaient avec force avant de suinter dans une pièce qui fait écho au prochain long métrage de Steve McQueen, Twelve Years a slave (sortie prévue fin 2013) fondé sur une histoire vraie, celle de Solomon Northup, né libre et kidnappé en 1841 à cause de sa couleur de peau, puis vendu comme esclave. « Nous faisions des repérages et avons trouvé cet arbre qui a été “utilisé” dans le film avant de s’apercevoir qu’il avait vraiment servi à lyncher des gens. C’était comme danser avec des fantômes. »
+41 61 335 32 32 – www.schaulager.org